Censés améliorer l’adhésion aux traitements, les outils numériques déçoivent.
Alarme sur smartphone, envoi de SMS, pilulier électronique, médicament connecté… Les nouvelles technologies développées pour améliorer l’adhésion thérapeutique sont une aide pour les patients, mais ne remplacent pas la relation soignant-soigné.
Médecine numérique, objets connectés, nouvelles technologies, plusieurs appellations désignent des outils qui visent à mieux mesurer et à améliorer l’adhésion des patients aux traitements. Alors qu’environ un malade chronique sur deux fait des infidélités aux prescriptions médicales, la nécessité de quantifier le phénomène est importante aussi dans les essais cliniques. Comment évaluer l’efficacité d’un antibiotique, d’un antidouleur ou d’une chimiothérapie si les médicaments ne sont pas pris correctement ?
Ces technologies sont très diverses. Au-delà des simples alarmes sur son smartphone, comme un nœud à son mouchoir, il existe de nombreuses applications, qui envoient des notifications (signal sonore, message…) pour la prise de médicament. Mais une revue de treize études publiées en 2017 ne trouve aucune preuve concluante d’amélioration de l’observance des médicaments prescrits pour un diabète ou une hypertension artérielle, grâce à des interventions de santé numériques telles que l’envoi de SMS…
« Ces outils peuvent être intéressants pour améliorer la non-observance non intentionnelle [oublis], par exemple lors d’une première prescription de pilule contraceptive pour des jeunes femmes », explique Stéphanie Sidorkiewicz, maître de conférences des universités en médecine générale à l’université Paris Cité, qui a fait sa thèse, en 2017, sur le sujet.
Plusieurs études ont montré une amélioration de la prise des traitements par l’envoi automatisé de SMS, comme dans le cas des antiagrégants plaquettaires après un infarctus du myocarde ou, en Afrique, dans le suivi des traitements antiviraux ou antituberculeux », soulignent, de leur côté, Nicolas Postel-Vinay, spécialiste de l’hypertension artérielle à l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) et ses collègues, dans un article publié dans la revue Médecine/Sciences, en septembre 2018.
Source : https://www.lemonde.fr/ Par Sandrine Cabut et Pascale Santi


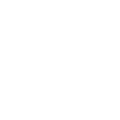 Professionnel
Professionnel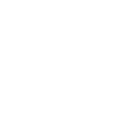 Prestataire
Prestataire
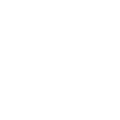 Fournisseur
Fournisseur
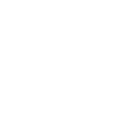 Autre
Autre